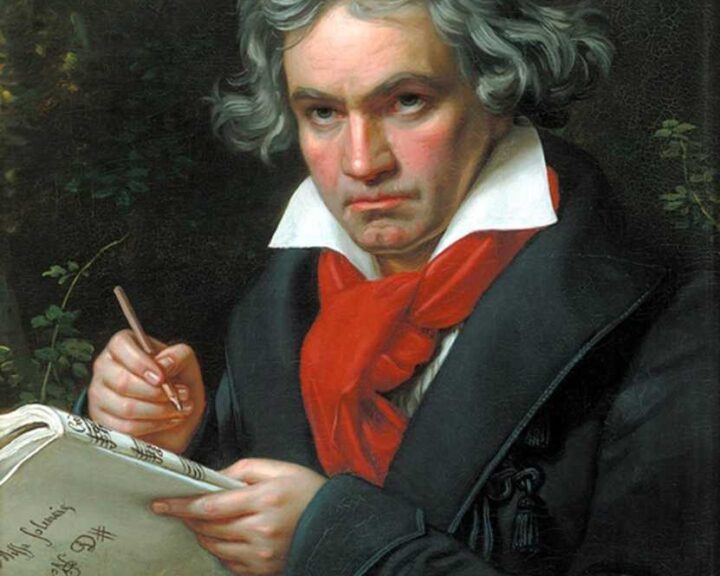“C’est dans le train qui me ramenait de Nice à Marseille que j’ai rencontré, le 1er janvier 1915, Guillaume Apollinaire. Je venais de passer mes vacances de Noël à Nice, dans la famille de mon frère aîné, sous-lieutenant d’artillerie aux Armées. Et je rentrais à Oran par le bateau qui partait de Marseille le soir-même, le Sidi-Brahim, je crois.
J’étais contente, mes vacances avaient été bonnes, ma valise était pleine de présents que je rapportais à ma mère, aux soeurs et aux petits frères qui m’attendaient, j’avais un joli chapeau dont j’étais très fière, le matin était radieux.
Prendre mon billet pour ce train de 8 heures, choisir un compartiment de seconde au beau milieu du wagon, tout cela m’avait paru facile et agréable. C’est donc avec assurance que j’y grimpai et que je plaçai ma valise dans le filet, un livre, un journal, un paquet de sandwiches à portée de ma main.

En gare, seulement quelques employés qui faisaient leur service. Bien calée dans mon coin, je me préparais à jouir jusqu’à Marseille d’une bonne solitude, quand un soldat entre dans mon compartiment, s’excuse vaguement en passant devant moi, et se penche à la portière pour parler à une dame qui l’accompagne. Est-ce un soldat ou un officier ? Je n’ai jamais su reconnaître un grade; il est grand, oui, plutôt grand, avec des jambes un peu courtes et un buste important ; il porte un képi rejeté en arrière.
Voilà ma solitude à l’eau. J’ai envie de m’en aller dans le compartiment voisin, mais comment partir sans me fare remarquer ? Cependant le soldat parle d’une voix douce : “Des vers ? Vous voulez lire des vers, dîtes-vous ? Lisez donc les Fleurs du Mal de Baudelaire.”
Il a bien dit : “Les Fleurs du Mal” de Baudelaire ? Je ne change pas de compartiment. (…)
Je lui tends en rougissant beaucoup le sandwich du compagnon de route qu’il accepte gentiment. Nous mangeons tous deux contents et libres au rythme du train qui accélère et je ne sais plus comment nous nous sommes mis à parler des poètes, je crois qu’il m’a demandé si j’aimais la poésie en engloutissant une tranche de jambon, et je lui ai répondu que je l’aimais autant que la vie dont, d’ailleurs je ne la séparais pas. Alors j’ai cru qu’il allait m’embrasser tant il était content et j’ai senti qu’il avait quelque chose à me dire, mais il s’est ravisé et a parlé des poètes.”
Madeleine Pagès, Tendre comme le souvenir, (Préface), Gallimard, 1952.
Je crois qu’il m’a demandé si j’aimais la poésie en engloutissant une tranche de jambon, et je lui ai répondu que je l’aimais autant que la vie…